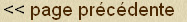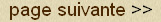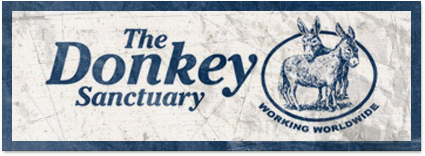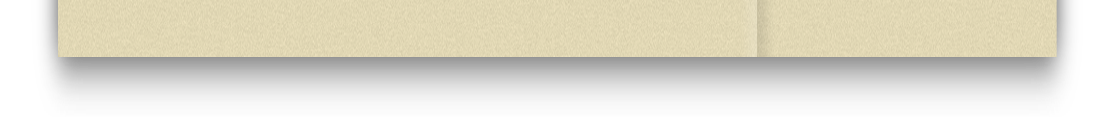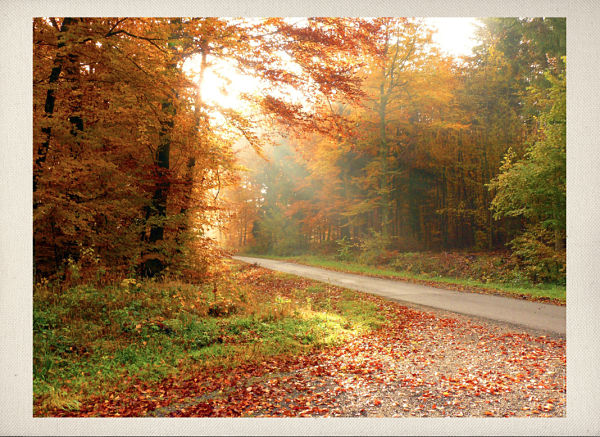

En voilà une question bien intéressante et posée récemment par un petit garçon de 5 ans qui regardait avec une grande curiosité notre grande volière : « Mais comment les oiseaux dorment-ils ? »
La plupart des oiseaux dorment la nuit et sont actifs le jour, tout comme les humains : ce rythme est inversé chez les rapaces nocturnes comme les chouettes et les hiboux, mais aussi chez certains canards comme l’Eider à duvet, la Sarcelle à ailes vertes et le Canard pilet. D’autres espèces comme le goéland argenté et le Canard noir dorment aussi bien le jour que la nuit. Il arrive aussi que certains dormeurs nocturnes fassent la sieste en plein milieu de la journée, lorsqu’il fait trop chaud pour accomplir quoi que ce soit d’autre !
L’oiseau adopte en général une position typique : les plumes sont plus ou moins ébouriffées, la tête est affaissée entre les épaules ou retournée vers l’arrière, et les yeux sont fermés. A intervalles réguliers (allant de quelques secondes à quelques minutes), un oeil ou les deux yeux s’ouvrent pour un court moment. Il semble alors que l’oiseau cesse de dormir et qu’il parcourt alors des yeux son environnement pour s’assurer qu’aucun prédateur ne s’approche.
La plupart des oiseaux dorment dans des endroits semblables à leur habitat de nidification. Ainsi, ceux qui construisent leur nid dans un arbre (comme le pinson, la corneille ou le geai) dorment le plus souvent perchés dans un arbre, tandis que ceux qui nichent dans des cavités (étourneaux, mésanges, pics, etc.) y passent aussi leurs nuits. Parmi les exceptions partielles à cette règle, on retrouve la Gélinotte huppée qui dort souvent sous la neige en hiver, et plusieurs espèces d’oiseaux de mer qui peuvent dormir sur l’eau.
Certaines espèces vont dormir en groupe, et il n’est pas rare que jusqu’à 500 000 étourneaux se rassemblent dans les roselières des étangs. Les moineaux dorment dans des dortoirs communs, et peuvent se rassembler à plusieurs centaines d’oiseaux, serrés les uns contre les autres, tout comme les cailles ! Ils se réchauffent ainsi mutuellement tout en se sentant plus à l’abri des prédateurs.
Détail intéressant, le Martinet noir, souvent confondu avec l’hirondelle, possède une technique unique pour se reposer : il dort en volant ! Sa technique est astucieuse : à la tombée de la nuit, il monte jusqu’à 1500 à 2000 mètres, donne des coups d’ailes pendant 4 secondes et se repose 3 secondes en planant les ailes bien étendues. Incroyable, non ?
 Le chaume est le terme générique désignant les toitures réalisées en matière végétale (paille de seigle, de blé, roseaux, bruyère, jonc, genets..). Il est utilisé depuis des temps ancestraux comme en témoigne des écrits datant de l’Égypte ancienne. Le toit de chaume représente l’élément typique de la maison normande rurale à qui il a donné son nom : la chaumière.
Le chaume est le terme générique désignant les toitures réalisées en matière végétale (paille de seigle, de blé, roseaux, bruyère, jonc, genets..). Il est utilisé depuis des temps ancestraux comme en témoigne des écrits datant de l’Égypte ancienne. Le toit de chaume représente l’élément typique de la maison normande rurale à qui il a donné son nom : la chaumière.
En France, les gaulois l’utilisaient pour couvrir leurs maisons et dépendances. La tradition du chaume s’est poursuivie ensuite au moyen-âge et ce n’est finalement que très récemment que les tuiles et les ardoises l’ont supplanté sur les maisons bourgeoises.
L’habitat pauvre a pourtant continué à utiliser le chaume pour couvrir les toitures ce qui explique pourquoi la chaumière est encore considérée comme une maison humble dans l’imagerie populaire. On le trouve dans toute l’Europe, et particulièrement en Angleterre, en Allemagne, et dans les pays scandinaves. En France, plusieurs régions ont gardé des habitations avec des toits de chaume (Bretagne, Normandie, Brière, Vendée, Massif central, Camargue…).
Au fil des temps, la paille de seigle qui était la plus utilisée en raison de sa souplesse et de sa facilité à l’emploi a été remplacée par le roseau de Camargue (la Sagne) ou par des roseaux venant de Pologne. Ce transfert de matériau n’est pas lié aux qualités de l’un ou de l’autre mais plutôt à sa rareté.
En Normandie, les baux de ferme prévoyaient le renouvellement des couvertures de chaume tous les dix huit ans. Mais bien faites, elles duraient entre trente et quarante ans si elles étaient faites en paille de blé, un peu plus si le chaume était en seigle et au moins un demi-siècle avec du roseau des marais !
Le secret de la résistance des tiges de graminées aux intempéries vient de la présence de silice. Ainsi, laissée à l’air libre et la pluie, la paille noircit, mais ne pourrit pas. De plus, elle assure un écoulement des eaux de pluie très rapide pour peu qu’elle soit bien « peignée » et que les brins de chaume soient parfaitement parallèles. Le chaume est un véritable régulateur hygrométrique qui évite la condensation en évacuant vers l’extérieur l’humidité de la maison. L’air ambiant n’est ni trop sec ni trop humide.
Si vous voyez parfois des iris au sommet des toits de chaume, ce n’est pas seulement pour « faire joli » (même si la poésie n’est pas exclue), mais c’est aussi parce que les rhizomes des fleurs fixent la terre et transmettent au chaume le taux d’humidité idéal pour qu’il assure l’imperméabilité du toit…

Originaire de Turquie, comme son nom l’indique, la Tourterelle turque a commencé à coloniser les pays voisins vers 1900, étendant progressivement son aire de répartition pour atteindre la France au début des années 1950 et la Normandie vers 1960.
Je suis toujours heureux d’entendre son roucoulement au petit matin lorsque nous ouvrons les volets de notre chambre…Ayant placé des mangeoires dimensionnée à sa taille et des graines correspondant à ses goûts, j’ai tout le loisir de l’observer en toutes saisons.
La tourterelle turque a toujours trouvé sa nourriture dans le voisinage de l’homme. En Normandie, elle partage les graines destinées aux poules et effectue de véritables raids dans les champs de blé et les cours de fermes. En hiver, les tourterelles turques errent en petites troupes dans les parcs et les espaces verts et fréquentent les aires de nourrissage destinées aux petits passereaux. Elles s’y montrent très pacifiques, se nourrissant serrées les unes contre les autres. Très tôt au printemps, elles exécutent leur spectaculaire vol nuptial : après un vol ascendant très abrupt, la tourterelle redescend en planant, avec les ailes recourbées vers le bas et en poussant des roucoulements sonores caractéristiques. Elle se perche volontiers sur les poteaux télégraphiques, les antennes TV et les toits, d’où elle pousse son cri répétitif.
La tourterelle turque a un cycle de reproduction assez exceptionnel. Bien qu’elle se reproduise principalement entre février et octobre, elle est capable de pondre tous les mois de l’année. Elle débutera parfois une nouvelle couvée alors qu’elle est encore occupée à nourrir ses petits ; on peut compter 6 couvées en une seule saison. Alors que plupart des autres oiseaux des parcs et des jardins alimentent leurs petits avec des insectes saisonniers, la tourterelle nourrit ses petits avec le « lait de pigeon », production du jabot riche en protéines et en graisse, ce qui lui permet de nourrir des oisillons presque en toutes saisons.
 Des pluies abondantes seront nécessaires cet hiver en France pour rétablir le niveau des nappes phréatiques, déjà affectées par la sécheresse du printemps et un début d’automne relativement sec, estime le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Ce constat intervient alors que l’organisme prévoit une diminution des pluies au XXIème siècle, ce qui devrait contraindre les Français à rationaliser leur consommation.
Des pluies abondantes seront nécessaires cet hiver en France pour rétablir le niveau des nappes phréatiques, déjà affectées par la sécheresse du printemps et un début d’automne relativement sec, estime le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Ce constat intervient alors que l’organisme prévoit une diminution des pluies au XXIème siècle, ce qui devrait contraindre les Français à rationaliser leur consommation.
Un été 2011 pluvieux a permis une légère amélioration du niveau des nappes mais des températures supérieures à la moyenne et de faibles pluies en septembre et en octobre – période où les nappes phréatiques commencent habituellement à se recharger – rendent la situation préoccupante. Il est désormais clairement dit par les spécialistes que le niveau de pluviométrie devra être important jusqu’au printemps prochain pour éviter un niveau alarmant des nappes phréatiques à l’approche de l’été 2012…
La France a connu en 2011 son printemps le plus chaud depuis 1900 et le plus sec depuis cinquante ans, obligeant les autorités à mettre en place des restrictions d’eau sur la majorité du territoire et à accorder aux agriculteurs plusieurs centaines de millions d’euros d’aides.
Près des 80% des nappes phréatiques en France affichaient des niveaux en-dessous de la normale au 1er novembre, selon le bulletin mensuel du BRGM. En octobre, les chutes de pluies ont été de 45% inférieures à la normale selon Météo-France. Le lien entre la diminution des chutes de pluies et le changement climatique n’est pas encore clairement établi, mais les modèles à long terme de Météo-France tablent pour les décennies à venir sur une réduction des pluies de l’ordre de 30% et prévoient des étés plus chauds. Une conjonction qui signifierait une aggravation des risques de pénurie en eau durant les pics de consommation estivaux.
Les hydrogéologues européens précisent par ailleurs que si aujourd’hui la situation globale est à peu près bonne, nous nous retrouverons dans une situation critique dans 10 à 20 ans », en restant sur les mêmes besoins et les mêmes prélèvements.
Le secteur agricole français est au coeur d’un débat tumultueux qui l’oppose aux groupes écologistes sur son rôle dans les dépenses en eau. Tous les spécislistes recommandent la nécessité de limiter certaines cultures, comme celle du maïs, très gourmande en eau, ou encore réduire les gaspillages d’eau potable qui atteindraient jusqu’à 20% des volumes en raison de fuites.
L’eau potable représente le plus gros volume extrait des réserves souterraines, avec 3,6 milliards de mètres cube pompés chaque année. Comparativement, l’industrie ne pompe qu’1,3 milliard de mètres cube et l’agriculture 1 milliard. Cette dernière se procure essentiellement de l’eau dont elle a besoin depuis des sources de surface, comme les rivières. Le niveau de la plupart des rivières françaises était proche de la normale au 1er octobre, selon la dernière actualisation effectuée par le ministère de l’Environnement.
Mais, selon les hydrogéologues français, il ne faut pas se fier à ces niveaux, les niveaux de surface et des nappes étant interdépendants, notamment l’été lorsque les nappes phréatiques permettent d’alimenter les rivières.
Pour résoudre durablement la question de l’approvisionnement, le BRGM étudie différentes options pour recharger artificiellement les nappes, incluant notamment la possibilité d’y injecter des eaux recyclées, ce qui n’est pas autorisé en France pour l’instant. Gageons que nous éviterons ces « tripatouillages »…
La côte méditerranéenne est l’une des régions les plus exposées en raison du risque de salinisation dans le cas où les nappes d’eau douce venaient à décliner fortement en raison du tourisme…
 Les migrations sont les déplacements saisonniers de certaines espèces qui voyagent en groupes et espèrent trouver une nourriture plus abondante sous un climat plus tempéré ou un endroit privilégié afin de mieux de se reproduire… C’est le cas de près de 40% des oiseaux d’Europe, mais aussi de la baleine à bosse et du manchot d’Adélie, ainsi que de quelques espèces de mammifères, de poissons, de crustacés et d’insectes.
Les migrations sont les déplacements saisonniers de certaines espèces qui voyagent en groupes et espèrent trouver une nourriture plus abondante sous un climat plus tempéré ou un endroit privilégié afin de mieux de se reproduire… C’est le cas de près de 40% des oiseaux d’Europe, mais aussi de la baleine à bosse et du manchot d’Adélie, ainsi que de quelques espèces de mammifères, de poissons, de crustacés et d’insectes.
Les animaux sont très sensibles au rythme des saisons, et savent exactement lorsqu’ils doivent partir ou revenir. Avec l’arrivée du printemps, les jours rallongent et la production d’hormones s’accélère. L’approche de l’hiver favorise le phénomène inverse. L’hirondelle fréquent volontiers l’hémisphère Nord à la belle saison, mais elle retourne avant l’hiver vers de cieux plus cléments, parcourant quotidiennement jusqu’à 320 km. L’oie à tête barrée peut parcourir jusqu’à 1600 km par jour !
Les itinéraires de migration répondent aux exigences et aux aptitudes des différentes espèces ; certains suivent des rivages, des berges ou fleuves, se regroupent pour passer les cols, les isthmes ou détroits, alors que d’autres filent droit, sous les mers, ou en survolant déserts et océans. Les routes ainsi suivies se croisent et se recroisent tissant un réseau très complexe autour de la planète.
Les migrateurs partent généralement après avoir fait le plein d’énergie, car leur trajet ne leur laissera généralement pas l’occasion de trouver assez de nourriture, notamment lors du survol des déserts et des montagnes ou des mers pour les oiseaux migrateurs. Cette énergie est stockée sous forme de graisse, qui sera consommée en cours de route, les animaux arrivant souvent à destination affamés et épuisés. Lorsque la réserve de graisse est insuffisante, l’animal peut mourir d’épuisement avant d’atteindre son but.
Si le phénomène de la migration des saumons et anguilles est connu depuis des milliers d’années, celui des oiseaux n’a été vraiment prouvé à la fin du XVIIIe siècle grâce au baguage des oiseaux. La migration de nombreux insectes, de chauve souris et des mammifères marins n’est étudiée que depuis quelques décennies. le suivi par satellite a permis de préciser certaines routes migratrices et de prouver que le voyage aller diffère du voyage retour et qu’au sein d’une espèce, des groupes peuvent suivre des voies très différentes pour rejoindre un même site. Chez une espèce de papillons d’Afrique du Nord les adultes migrent vers le grand nord. Ils y meurent après avoir pondu, et l’année suivante, c’est la nouvelle génération qui migre vers le sud.
Quant à la baleine à bosse, elle parcourt à l’approche de l’hiver des milliers de kilomètres à travers les océans depuis sa zone d’alimentation (autour des pôles) vers des zones de reproduction (dans les eaux équatoriales). Ces dernières sont dépourvues de nourriture, mais propices à la reproduction et au développement du baleineau. : il se nourrit alors du lait de sa mère, tandis que les baleines adultes vivent sur leurs réserves de graisse. Les mouvements migratoires sont inversées entre les baleines de l’hémisphère Nord (qui se nourrissent majoritairement de poissons) et celles de l’hémisphère Sud (qui consomment une grande quantité de crevettes et autres crustacés).
 Il y a au moins trois bonnes raisons de manger local.
Il y a au moins trois bonnes raisons de manger local.
D’abord, parce que notre approvisionnement dépend pour une trop large part d’importations en provenance de pays parfois lointains, ce qui le rend fragile. Ensuite, parce que ces importations sont coûteuses en pétrole, et en pollutions qui viennent accroître le réchauffement climatique. Enfin, parce que privilégier les « circuits courts » permet de renouer un lien avec les producteurs locaux et de savoir comment est produit ce que l’on mange. Comment faire pour manger local ? Retrouver la maîtrise de son alimentation oblige à réapprendre des gestes souvent oubliés (jardiner, préparer des conserves…) et à redécouvrir la coopération et l’entraide qui conditionnent la plupart du temps la réussite.
Pour aider à cette grande « requalification », les auteurs du livre « Manger local » proposent vingt-six initiatives qui reposent sur des expériences réussies et facilement reproductibles, des plus simples à mettre en oeuvre (constituer un réseau de paniers, approvisionner une cantine en produits bio et locaux ou démarrer son potager) aux plus « engagées » (se réunir autour d’un jardin partagé, créer un éco-hameau, mettre les initiatives locales en réseau…).
Chaque initiative est accompagnée de conseils pratiques pour l’adapter à son propre territoire, et d’adresses utiles pour se mettre en relation avec d’autres projets et passer à l’action.
 Symbole de la vie, de la forme parfaite, l’oeuf a nourri l’imaginaire de nombreux peuples dont beaucoup s’accordent à penser qu’avant notre monde se trouvait un oeuf primitif… Longtemps, le coq fut sacré car il était capable par son chant de faire naître le jour. Ce serait en vertu de ce prétendu pouvoir qu’il orne si souvent les clochers d’église.
Symbole de la vie, de la forme parfaite, l’oeuf a nourri l’imaginaire de nombreux peuples dont beaucoup s’accordent à penser qu’avant notre monde se trouvait un oeuf primitif… Longtemps, le coq fut sacré car il était capable par son chant de faire naître le jour. Ce serait en vertu de ce prétendu pouvoir qu’il orne si souvent les clochers d’église.
Les Français aiment les oeufs. Au pays qui justement tient son ancien nom (Gaule) du coq (gallus), on en consomme aujourd’hui en moyenne 250 par an et par personne, produits transformés compris, soit la production annuelle d’une poule pondeuse d’élevage. Même si nous sommes loin derrière les Chinois ou les Japonais et leurs 300 oeufs annuels, cet aliment basique occupe tout de même une place centrale dans nos menus et à juste titre. En effet, les nutritionnistes sont unanimes : l’oeuf concentre de nombreux nutriments et renferme tous les acides aminés essentiels, il est même considéré comme la protéine de référence par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Pour répondre à sa consommation croissante, des élevages industriels se sont développés dans la seconde moitié du XXe siècle, produisant toujours plus à moindre coût. Les pondeuses ont été entassées dans des bâtiments fermés, sans contact avec l’extérieur, et surtout dans des cages, tellement pratiques à empiler sur plusieurs mètres de haut. Aujourd’hui en France, on élève 43 millions de pauvres poulettes dont 80 % vivent ainsi, en «batterie », sans jamais voir le jour… ni même de coq !
En réponse à ces atteintes au bien-être animal, des modèles alternatifs ont vu le jour sous la pression d’associations de protection des animaux et des consommateurs : plein air, Label Rouge et bien avant, bio. Ces filières représentaient 20 % des poules pondeuses en 2009, contre 4 % en 1990.
Parmi ces alternatives, l’oeuf bio a le vent en poupe : ses ventes ont enregistré la plus forte progression en pour atteindre 7 % du total d’oeufs vendus.
Mais quelle réalité se cache derrière ces chiffres apparemment satisfaisants ? Et qui s’intéresse réellement à l’oeuf alors que nous en consommons en permanence, parfois même sans nous en rendre compte ?
Téléchargez ici l’excellent article de Consom’action qui fait le point sur le sujet.

Plus de 24 000 espèces animales et végétales sont actuellement en danger tandis que 801 se sont éteintes en 2011. C’est du moins ce qu’il ressort de la nouvelle liste rouge des espèces menacées que vient de publier l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Avec près de 62 000 espèces étudiées, cet instrument est aujourd’hui l’un des plus complets pour se faire une idée de l’état de la biodiversité. Chaque espèce ou sous-espèce prise en compte y est classée selon neuf catégories : éteinte (801 en 2011), éteinte à l’état sauvage (64), en danger critique d’extinction (3 879), en danger (5 689), vulnérable (10 002), quasi menacée (4 389), faible risque, dépendant de la conservation (257), données insuffisantes (9 709), objet de préoccupation mineure (27 124).
La mise à jour 2011 de ce baromètre de la vie révèle notamment que près de 25 % des mammifères sont désormais menacés d’extinction, au premier rang desquels de nombreuses espèces de rhinocéros. L’animal est victime non seulement de la destruction de son habitat naturel, mais aussi d’un braconnage intensif résultant d’une demande croissante de cornes. Celles-ci sont utilisées pour réaliser des sculptures, mais aussi, en poudre, par la médecine chinoise ou pour leurs supposées vertus aphrodisiaques.
La situation des thons est également très critique puisque cinq des huit espèces répertoriées figurent aujourd’hui dans les catégories menacées ou quasi menacées. De même, près de 40 % des reptiles terrestres de Madagascar sont en souffrance. Vingt-deux espèces de l’île, dont des caméléons, des geckos, des scinques ou encore des serpents, sont classés en danger critique d’extinction.
Sur d’autres îles, dans l’archipel des Seychelles, c’est l’état de la flore qui s’avère très préoccupant : 77 % des plantes à fleurs endémiques y sont menacées de disparition. Toujours concernant les espèces végétales, une évaluation de l’ensemble des conifères a été réalisée. Elle révèle que le sapin d’eau chinois (Glyptostrobus pensilis), autrefois très courant en Asie, est désormais lui aussi en danger critique d’extinction, victime de l’agriculture intensive. Quant au Taxus contorta, autre conifère, il décline notamment sous l’effet de la surexploitation à des fins médicinales, puisqu’il entre dans la composition de médicaments utilisés en chimiothérapie.
Au-delà d’un constat alarmiste, la liste rouge de l’UICN examine à chaque fois attentivement les causes du déclin de chaque espèce. Des informations précieuses qui peuvent permettre aux décideurs de chaque pays d’envisager des mesures de protection appropriées. Car, dans certains cas, les dispositifs mis en place finissent par porter leurs fruits. Ainsi, la liste rouge 2011 comporte aussi quelques bonnes nouvelles pour la biodiversité. Le rhinocéros blanc du Sud, qui était passé sous la barre des cent individus à la fin du XIXe siècle, compte aujourd’hui plus de 20 000 représentants. De même, le cheval de Prjevalski, classé comme éteint à l’état sauvage en 1996, a bénéficié d’un programme de reproduction en captivité, puis d’un programme de réintroduction réussi : 300 de ces animaux vivent aujourd’hui de nouveau à l’état sauvage.