
Je crois vous l’avoir déjà dit… tel un bourdon qui butine de fleurs en fleurs, je visite bien des endroits en profitant de mon métier de pilote de ligne. J’observe, je compare, j’écoute, je prends des idées, bref… je picore ça et là au gré de mes rencontres et de mes expériences.
Samedi midi, de retour de mon rendez-vous au jardin botanique de New-York (si vous passez par New-York, je vous conseille vivement la visite de ce bel endroit), je fais un stop par le magasin Home Depot qui se trouve à proximité de mon hôtel. « Home Depot » c’est un peu notre Leroy Merlin en version XXL et justement en pénétrant dans le magasin, je me rends compte que l’allée centrale est encadrée à perte de vue de produits « Roundup ».
Et lorsque je dis « à perte de vue », je n’exagère nullement. Je décide de m’avancer et je dois vous avouer que j’ai frémi en constatant en combien de produits et contenants différents était décliné le Roundup. J’ai pu constaté une fois de plus combien le poison « Roundup » faisait partie du quotidien des Américains.
Aux Etats-Unis, lorsqu’un américain a soif, il pense « Coca », s’il a faim il pense « hamburger » et s’il veut désherber son jardin (si petit soit-il) il pense à… Roundup !
Roundup est une marque d’herbicides produits par la compagnie américaine tristement célèbre Monsanto. La molécule active mentionnée sur le produit est le glyphosate que l’on retrouve dans les nappes phréatiques à proximité de là où il est utilisé, comme dans les eaux de certaines régions françaises : 55 % des nappes superficielles et 2,7 % des nappes souterraines (voir les rapports d’analyse des DDASS ou des SAGE) !
De nombreuses études ont démontré la toxicité du Roundup pour l’environnement : une étude réalisée par deux chercheurs français, Gilles-Eric Séralini et Nora Benachour de l’Université de Caen, ont fait des essais avec des cellules de nouveau-nés issues de cordons ombilicaux. Ils ont utilisé des doses de produits 100 000 fois inférieures à celles avec lesquelles le jardinier du dimanche est en contact.
Les résultats on été très explicites : le glyphosate et les adjuvants présents dans le Roundup programment « la mort des cellules en quelques heures avec extension aux tissus et aux ADN, pouvant provoquer des maladies chroniques« . Et les chercheurs de rajouter : »Les risques sont avant tout pour les femmes enceintes mais pas seulement », soulignant également des risques probables d’allergie et de cancer.
L’Académie américaine des sciences organisait le 10 mai un sommet sur les plantes génétiquement modifiées résistantes aux herbicides. Une réunion de crise pour être plus précis ! L’objet de la crise ? Très simple : Monsanto a déclaré aux agriculteurs américains pendant des années qu’avec les OGM résistants aux herbicides ils n’auraient plus jamais de problèmes avec les mauvaises herbes. Il leur suffisait de pulvériser du Roundup pour être tranquilles. Un seul passage était nécessaire pour tout détruire sauf les cultures dotées d’un gène de résistance. Les agriculteurs ont bénéficié de ce système au début : les rendements étaient meilleurs, le temps de travail et les coûts réduits. Aujourd’hui, ils déchantent, pire ils se rendent compte d’une situation qui risque d’être catastrophique.
Les mauvaises herbes deviennent résistantes elles aussi au Roundup, elles se multiplient très vite et envahissent les champs de soja, de maïs, de coton et de colza. Près de 8 millions d’hectares sont d’ores et déjà infestés. Et de se rendre compte qu’avec les herbicides, il se passe la même chose qu’avec les antibiotiques. À les utiliser trop souvent et systématiquement, ils perdent leur efficacité car les plantes développent des résistances ! Les OGM ont fait exploser la consommation de glyphosate : elle est passée dans les champs de maïs de 1,8 million de tonnes en 2000 à 30 millions de tonnes l’an dernier.
Chaque année, de nouvelles plantes sauvages développent des résistances. Leurs mécanismes de défense sont efficaces et, une fois sélectionnés, ils sont transmis à leur nombreuse descendance. On a déjà recensé près de 400 espèces sauvages résistantes !
En Alabama, l‘amarante de Palmer, une grande plante buissonnante qui pousse très vite et produit des millions de graines minuscules, infeste 80 % des champs de coton OGM et 61 % des champs de soja OGM. Le préjudice pour les agriculteurs est estimé à des dizaines de millions de dollars.
Pour faire face à la situation, Monsanto projette d’associer d’autres herbicides, ce qui accroîtra la pollution, et ajoutera très logiquement un nouveau gène de résistance dans les plantes cultivées. La sensibilité des plantes aux herbicides est un bien commun et l’agriculture industrielle est en train de le détruire. Pour faire plus court, on va dans le mur !
Des alternatives aux OGM sont d’ores et déjà recherchées. Des moissonneuses-batteuses capables de trier à part les graines des mauvaises herbes et de les broyer sont testées en Australie. La maîtrise des mauvaises herbes demandera sûrement plus de travail, mais c’est le prix d’une agriculture raisonnée avant qu’il ne soit définitivement trop tard…
Comme vous pouvez l’imaginer, l’emploi des herbicides est absolument prohibé au Relais du Vert Bois !

Membre de la famille des psittacidés, la perruche à collier est capable, comme bien d’autres perroquets – en captivité – d’imiter la voix humaine.
S’agissant de nos propres perruches à collier installées dans une vaste volière extérieure, celles-ci s’expriment plutôt bruyamment, mais plutôt dans leur propre langage !
On connaissait déjà la perruche à collier dans la Rome antique, à l’époque de Jules César, où un oiseau doué pouvait coûter plus cher qu’un esclave. Haute d’une quarantaine de centimètres, elle est dotée de magnifiques couleurs généralement unies (à part pour certaines hybridations) pouvant aller du jaune au vert, en passant par le bleu et le gris. Toutes les perruches à collier sont pourvues d’une longue queue et pour les mâles, d’un collier noir. Depuis une trentaine d’année et insidieusement, elle a entrepris de mettre sa touche de couleur et d’exotisme dans les parcs, bois et jardins franciliens.
Comme c’est souvent le cas, une espèce peut devenir endémique d’un lieu, d’une région ou d’un territoire plus vaste après s’être échappée de lieux de captivité plusieurs générations en arrière… Reine de l’évasion, les Anglo-Saxons l’ont surnommée la perruche Houdini. Une cinquantaine d’individus se seraient échappés d’un conteneur sur la zone aéroportuaire d’Orly en 1974. Le scénario s’est reproduit dans les années 1990, à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Depuis cette époque et la nuit venue, les perruches sont nombreuses à se regrouper tant en dortoir à Wissous à quelques kilomètres à vol d’oiseau (le mot pour rire…) d’Orly ainsi qu’à Roissy (95) en bordure des pistes. Selon la Ligue de protection des oiseaux (LPO), on dénombrerait aujourd’hui près de 1 500 individus en Ile-de-France.
À Antony, en région parisienne et toujours à proximité de l’aéroport d’Orly, certains habitants sont partagés. Depuis quelques années, une colonie a élu domicile dans le parc d’une résidence. Si l’oiseau et ses couleurs chatoyantes ravissent quelques personnes qui parfois les nourrissent, les déjections qui s’accumulent sur les voitures garées en contrebas ne sont pas du goût de leurs propriétaires…
On peut également en apercevoir au parc de Sceaux, au parc de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry, dans le bois de Vincennes et au parc Monsouris. En Grande-Bretagne, où elle est apparue à la fin des années 1960, la population de perruches à collier s’élève désormais à environ 20 000 individus , dont 10 000 pour Londres et sa banlieue ! Et on la trouverait jusqu’au sud des Highlands. Dans le reste de l’Europe une colonie d’environ 10 000 individus vit dans la région bruxelloise. On la retrouve aussi à Zurich, Hambourg, Barcelone… Psittacula krameri manillensis est le psittacidé le plus répandu dans le monde. Celles qui se sont adaptées à notre pays sont originaires du sous-continent indien. Là-bas, elle est considérée comme nuisible. Elle mange en abondance des fruits et des graines. Elle serait responsable de la perte de près de 20 % des récoltes de maïs.
Comme le rappelle le journaliste Philippe Martinot, depuis 2008 l’observatoire de la faune britannique Natural England, a mis l’oiseau sous surveillance et autorise, sous condition, un propriétaire foncier à le tirer sans demander un permis.
Xavier Japiot, ornithologue à Paris Nature, le pôle biodiversité de la Mairie de Paris, explique qu’en France cet oiseau ne bénéficie d’aucun statut particulier. Cela n’empêche pas que certains ornithologues soient inquiets : la perruche à collier cause des dommages aux cultures, surtout aux arbres fruitiers, dans son aire de nidification naturelle. De plus, l’oiseau, cavernicole, est soupçonné de chasser d’autres espèces nichant dans les cavités comme les pics, les sittelles, les étourneaux voire les chouettes et même les écureuils.
En Ile-de-France, des ornithologues surveillent avec attention la progression de l’oiseau. Si l’état actuel et l’impact de cette population restent faibles, des études estiment cependant qu’elle pourrait être multipliée par dix dans les dix ans qui viennent. Parmi les mesures envisagées, ils préconisent de proscrire le nourrissage direct par le public, cause de la prolifération sauvage des espèces exotiques. Une mesure de bon sens, pour éviter que la perruche à collier ne devienne une «peste» céleste.

Voir des marmottes se mérite et fait partie des petits plaisirs lorsqu’on se balade en moyenne montagne (entre 1000 et 3000 mètres d’altitude). Mais lorsqu’un dépliant touristique invite les promeneurs à venir sans effort observer ces petits mammifères sur un sentier dédié, parents et enfants affluent au risque de faire péricliter la vie du tranquille petit rongeur!
C’est ce qui se passe notamment dans les Hautes-Alpes sur la commune d’Eygliers. Il y a là, une colonie de marmottes plutôt habituée à l’Homme et donc très facile d’approcher. Seulement voilà, on a beau rappeler qu’il ne faut pas les nourrir, bien des promeneurs n’ont pas ces scrupules et font courir un véritable danger aux marmottes en leur donnant littéralement n’importe quoi à manger : popcorn, chips, morceaux de chocolat, pain, etc.
A force d’être gavées les marmottes finissent par développer de l’eczéma, du diabète et entament leur hibernation dans de très mauvaises conditions.
En temps normal, une marmotte est uniquement herbivore : elle se nourrit de plantes et de légumineuses qui leur apportent par ailleurs une partie de l’eau dont elles ont besoin; ces petits rongeurs ne boivent pas mais récupèrent en revanche la rosée qui perle sur les plantes.
La marmotte hiberne presque 6 mois. En automne elle mange énormément pour constituer les réserves de graisse qui lui permettront de survivre. Pour ne pas brûler ses réserves trop vite elle vit au ralenti. Son cœur bat très lentement. Elle se réveille environ toutes les quatre semaines pour faire ses besoins. S’il fait moins de 3 degrés sous terre, la marmotte doit se réveiller et bouger pour ne pas mourir de froid.
La Marmotte, très sociable, vit en petites colonies de type matriarcales, d’origine familiale. Un groupe comporte 5 à 12 individus : un couple reproducteur accompagné de ses descendants des 2 ou 3 dernières années. Il y a une famille par terrier.
La marmotte est strictement diurne, ce qui est rare pour un mammifère sauvage. Elle se lève tôt (avant le lever du soleil), se toilette comme un chat et prend son premier repas du matin. Elle débute ensuite une sieste dans la matinée, étalée en long sur un gros rocher, mais toujours vigilante, les yeux ouverts. Elle rentre dans son terrier aux heures chaudes de la journée pour dormir au frais, prend alors un second repas, avant de se coucher avant la nuit. Une vie donc bien réglée, ponctuée par le jeu car la curiosité des marmottes les rend particulièrement joueuses.
Bien que la population de marmottes dans le monde ait connu une forte diminution depuis ces dix dernières années, et que sa présence reste très discrète, certains pays connaissent une forte proportion de marmottes. C’est notamment le cas du Canada, de la Suisse et de la France où l’espèce est proétégée. Actuellement, on peut comptabiliser environ 16 000 marmottes en France. Elle a été réimplantée dans les Pyrénées au cours des années 1950 et introduite dans le Massif central (Drôme, Cantal, Ardèche) à partir du milieu des années 1960. Les essais de repeuplement dans les Vosges et le Jura français n’ont pas franchement abouti.
Si autrefois, l’homme l’a chassée pour sa viande, sa graisse et sa peau, c’est surtout l’aigle qui, aujourd’hui, est son plus grand prédateur. Les marmottes représentent, en effet, jusqu’à 90% des proies capturées par ce rapace. Le renard n’est pas en reste non plus… La longévité de la marmotte est de 15 à 20 ans en captivité, elle est inconnue dans la nature.
Les outils de défense dont dispose la marmotte pour échapper à ses prédateurs sont avant tout sa vue qui, si elle n’est pas excellente, a au moins l’extrême avantage de couvrir un champ visuel de 300 degrés (160 degrés chez l’homme), il est donc très difficile de la surprendre. Son odorat, de même que son ouïe, sont très performants et complètent ses armes.
Il n’y a pas de guetteur attitré dans le groupe. Chacun vaque à ses occupations en se préoccupant de ce qui se passe autour, en adoptant la position caractéristique « en chandelle ».
A la moindre alerte, la marmotte siffle à plusieurs reprises. Pour un aigle repéré, le cri bref, strident, envoie tout le monde au fond du terrier. Pour un quadrupède, voire un bipède, l’appel est différent et les autres marmottes vont plutôt aller voir la cause de l’alerte avant, éventuellement, de se cacher.

La reine a pour unique mission d’assurer le renouvellement permanent des membres de la colonie, puisqu’elle est la seule féconde. La pérennité de la ruche dépend entièrement de ses pontes. À la belle saison et au mieux de sa forme, une reine pond plus de 2 000 oeufs par jour, soit plus d’un oeuf par minute ! Pour atteindre ces formidables performances, elle est abondamment nourrie de gelée royale et fait l’objet des soins attentifs de sa cour.
La reine se distingue des ouvrières par sa taille : elle mesure 18 à 20 mm (les ouvrières 14 à15 mm), son thorax est plus large et son abdomen plus long. Ces ovaires occupent presque tout son gros abdomen. Tous ce qui n’est pas utile à sa mission de ponte n’est pas présent chez la reine. Dans de bonnes conditions, elle peut vivre 4 à 5 ans.Autant dire que « Madame la Reine » aura alors libéré plus d’un million d’œufs et c’est dans la nature un exemple de fécondité qui n’est surpassé que par de rares espèces.
Cette fécondité n’est pas éternelle et passe par un maximum au moment de sa deuxième année puis décline après la troisième pour être réduite pendant la quatrième. En fin de vie, il arrive qu’elle devienne « bourdonneuse », c’est à dire qu’elle ne donne naissance qu’à des mâles (ou faux bourdons). Dans ce cas les œufs ne sont pas fécondés car la reine a épuisé la provision de liqueur séminale de sa spermathèque et ne pond alors que des œufs sans spermatozoïdes qui ne vont donner que des mâles.
Elle se comporte comme une reine non fécondée : ce sera la perte de la colonie car il n’y aura plus assez de naissances pour assurer la relève. Les abeilles vont vite sans rendre compte et se débarrasser de leur vieille Reine sans pitié en élevant une autre reine à partir d’un de ses oeufs. La vieille Reine ne sera plus alimentée et devra s’enfuir avec un bon paquet d’abeille : c’est ce que l’on appelle communément « l’essaimage ».
Confrontée à la dégradation de l’environnement, depuis quelques années, l’espérance de vie de la Reine des abeilles peut se réduire de manière préoccupante à 1 ou 2 années seulement.
La reine est issue d’un oeuf placé dans une cellule spécifique en forme de doigt et qui pend sur le cadre. Les ouvrières en quête d’une nouvelle souveraine laissent éclore la larve et la nourrissent exclusivement de gelée royale, une sécrétion des glandes hypopharyngiennes présentes dans la tête des ouvrières.
À peine née, la reine élimine ses rivales potentielles. Elle repère les cellules royales et y tue les larves ou les nymphes qui s’y trouvent : il ne peut y avoir qu’une seule reine dans la ruche. Au bout de quelques jours, elle s’envole pour être fécondée par les faux-bourdons (les abeilles-mâles) : c’est le vol nuptial. La reine connaît plusieurs accouplements avec différents mâles. Lorsque sa spermathèque est pleine, elle retourne dans la ruche, dont elle ne sortira plus.
Quelques jours après sa fécondation, la reine commence à pondre.
Les ouvrières sont issues d’oeufs fécondés, les faux-bourdons d’oeufs non-fécondés, déposés dans des cellules plus grandes. Des ouvrières entourent constamment la reine. Elles veillent sur elle en la nourrissant et la nettoyant constamment.
Au bout de 3 jours, l’oeuf éclot. Débute alors le stade larvaire. Au neuvième jour, les larves alimentées par les nourrices sont devenues grandes. Les ouvrières ferment alors leur cellule par un opercule de cire. Quelques jours plus tard, la larve se transforme en nymphe. L’ouvrière rompt l’opercule et s’extrait de sa cellule 8 jours plus tard.
S’agissant des faux-bourdons, ceux-ci sont plus trapus, plus velus, que les ouvrières. Ils naissent uniquement au printemps et on en dénombre quelques centaines dans une colonie. Leur rôle est de féconder la reine. Ceux qui y parviennent en meurent : leur appareil génital est arraché lors de la fécondation. Incapables de butiner, les faux-bourdons puisent dans les réserves de miel de la ruche. À l’automne, quand la nourriture devient moins abondante, les faux-bourdons sont tués ou expulsés de la ruche. Ne sachant pas se nourrir seuls, ils meurent.
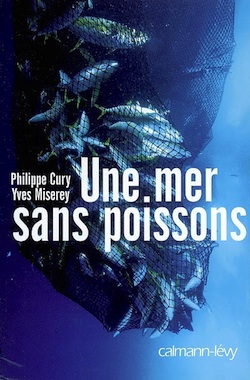 On pille, on détruit, on pollue les océans, et c’est la mort des poissons. Les scientifiques et les ONG ont peur. Les uns publient livres et études, les autres tentent d’intercepter les navires-usines… Tous proposent des solutions pour sauver ce bien commun de l’humanité.
On pille, on détruit, on pollue les océans, et c’est la mort des poissons. Les scientifiques et les ONG ont peur. Les uns publient livres et études, les autres tentent d’intercepter les navires-usines… Tous proposent des solutions pour sauver ce bien commun de l’humanité.
«Une mer sans poissons » est le titre anxiogène d’un livre (également disponible en format numérique) coécrit par Philippe Cury, chercheur à l’Institut de recherche pour le développement, à Marseille, et le journaliste Yves Miserey. Les deux auteurs démontrent précisément que la pêche contemporaine est prédatrice. Et avec l’amélioration des moyens technologiques, on est passé de l’exploitation à la surexploitation des océans, dont les trois quarts sont dans une situation critique.
En mer du Nord, 88 % des ressources marines subissent une pression trop forte. En 50 ans, les prises ont été multipliées par 5 : on est ainsi passé de 20 à 100 millions de tonnes annuelles. Philippe Cury parle de « véritable razzia ». On pêche trop mais aussi des espèces en voie de disparition, comme l’esturgeon, le grenadier, le requin. « Ça ne vous viendrait pas à l’esprit de manger du panda ? » lance-t-il, provocateur.
La pêche de l’empereur en eaux profondes, commencée au début des années 90, a été interdite en 2010. Extinction commerciale de l’espèce en 20 ans ! Claire Nouvian a créé l’association Bloom fin 2004. Elle milite contre la pêche en eaux profondes. La langue de bois, elle ne connaît pas. Elle lit toutes les études, voyage entre l’Asie, l’Europe et les Etats-Unis pour dénoncer « un océanocide ».
Sur la page d’accueil de son site, www.bloomassociation.org, une image : un nuage nucléaire en forme de champignon sous l’eau et à la surface, un énorme chalutier avec cette phrase : « La pêche en eaux profondes est une arme de destruction massive. » Sans compter que les poissons sont particulièrement pollués, bourrés de métaux lourds. L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) déconseille leur consommation aux enfants de moins de 30 mois. Si c’est dangereux à 2 ans et demi, pourquoi pas à 3 ? C’est pourtant ce qu’on retrouve dans les assiettes des cantines : du hoki de Nouvelle-Zélande, à une époque où, soit dit en passant, il est de bon ton de respecter des cycles courts.
De même, la saumonette entre dans la composition de nombreux plats cuisinés. Un joli nom pour ce qui est en fait du requin, vendu également sous l’appellation « veau de mer » ! François Chartier, chargé de campagne Océans pour Greenpeace France, est pessimiste. « La taille des poissons a fortement diminué. On prélève beaucoup trop de juvéniles ou de reproducteurs. Et de conclure : le portrait est noir, la situation des océans est inquiétante. »
Ça ne sort pourtant pas d’un film de science-fiction mais d’un livre d’histoire. Le drame a déjà eu lieu au Sénégal avec le « thiof » (grand mérou), comme le rappelle Philippe Cury, ou à Terre-Neuve avec l’effondrement de la population de morues (encore appelé cabillaud), une des plus graves crises halieutiques du XXème siècle. L’interruption de cette pêche dans les années 90 a eu des impacts socio-économiques très larges, notamment le chômage de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Malgré le moratoire sur la pêche, les morues ne sont pas revenues. Pourtant, « la mer est très patiente avec nous », affirme Daniel Pauly, professeur à l’université de Colombie-Britannique, à Vancouver, considéré comme un des plus grands spécialistes au monde des pêches. Que se passe-t-il donc à Terre-Neuve avec les morues ? L’homme a tout simplement modifié l’écosystème. Il est occupé à présent par d’autres espèces, notamment les harengs qui mangent les larves de morue !
Et la démesure ne s’arrête pas pour autant : en 2008 la société hongkongaise Pacific Andes a investi 100 millions de dollars dans un ancien navire-citerne, aussi long que deux terrains de football et muni d’une flotte de chalutiers qui pêchent en aspirant les poissons. L’espèce concernée : le chinchard, destiné à être transformé en farine. Même réalité pour la pêche au krill en Antarctique – cette petite crevette est la nourriture des baleines mais, réduite en farine, c’est aussi celle des poissons d’élevage.
Daniel Pauly renchérit avec l’humour qui le caractérise et ce malgré la gravité de la situation : « On agit avec les océans comme un vieux qui déciderait de prendre tout son argent et de le dépenser en une nuit à Las Vegas au lieu de le placer à la banque et de vivre des bénéfices. Si on laisse un stock de poissons tranquille, il augmente. Il faudrait ne pêcher que le surplus, les bénéfices en quelque sorte, sans toucher au capital. » Cela suppose une forte volonté politique pour faire respecter les quotas produits par les scientifiques. Or, avant que des ONG comme Greenpeace ne s’en mêlent, les scientifiques recommandaient de ne pas dépasser 15 000 tonnes de thon rouge. Les politiques ont alors placé la barre à 30 000, par peur de mouvements sociaux. Avec les prises illégales, parce que les autorités a fermé les yeux, on est arrivé à un chiffre avoisinant les 60 000.
Autre problème politique complètement tabou : les subventions. Les professionnels ont extorqué des sommes ahurissantes à l’Etat français. Ils empêchent tout débat sur la question. Or, c’est l’argent du contribuable. Quand le prix du gazole grimpe, si les subventions ne sont pas augmentées, les pêcheurs bloquent les ports. Plutôt que d’utiliser les subventions pour soutenir la pêche de stocks épuisés, on ferait mieux de les employer à inciter les pêcheurs à partir à la retraite.
En France, l’association Bloom dont je vous parlais plus haut dénonce également ces subventions qui aident à renouveler les flottes de pêche industrielle et à augmenter la capacité des grands chalutiers. Sans les subventions, pas de pêche. Le rapport dépenses-recettes est déficitaire, ne serait-ce qu’au regard des énormes consommations de gazole que suppose la sortie en mer de ces vaisseaux de plusieurs dizaines de mètres, qui brûlent 7 000 litres de carburant par jour contre 30 à 100 litres pour un petit bateau !
Si comme moi vous aimez le poisson et que vous désirez « manger intelligent », allez donc faire un tour sur le site Internet mrgoodfish.com qui réactualise tous les mois les espèces qu’on peut consommer sans mauvaise conscience. Un article particulièrement intéressant d’Emmanuelle Jary est à lire dans le dernier numéro de Paris Match et intitulé « La Mer Épuisée ».

Jolie scène de coucher de soleil à proximité des champs de blé du Relais du Vert Bois…

L’impact du réchauffement climatique est bien connu sur la faune et la flore. Ces dernières tentent de migrer pour survivre. En montagne, les espèces prennent donc de l’altitude. Jusqu’à un certain point…
Les aires d’accueil deviennent en effet de plus en plus petites et la compétition entre les espèces de plus en plus grande. Une étude scientifique récente montre que dans les Alpes, le phénomène pourrait être pire que ce qui a été envisagé jusqu’à présent. Alors que les glaciers ont perdu 40% de leur surface et plus de 50% de leur volume depuis 1850, près de la moitié des espèces devraient disparaître d’ici la fin du siècle et la résistance apparente de certaines autres ne pourrait être que temporaire.
À l’aide d’expérimentations, les scientifiques ont établi le chemin que parcourent certaines graines qui dans la nature sont emportées par le vent. Ils ont de la même manière identifié les espèces clonales qui se dispersent par les racines. Elles vivent extrêmement longtemps – parfois plusieurs centaines d’années – et donc se reproduisent sur une très longue période.
Beaucoup de ces plantes n’auront donc pas le temps de s’adapter. La vitesse du réchauffement devenant bien trop rapide par rapport à leur vitesse de reproduction… Pour rappel, en 30 ans les activités printanières des êtres vivants ont avancé de presque une semaine en Europe !
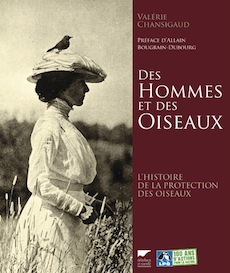 A l’occasion du centenaire de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), l’ouvrage « Des Hommes et des Oiseaux » rassemble plus de 300 illustrations et photographies, une chronologie détaillée pour repérer les événements clés de la protection des oiseaux et une abondante documentation internationale qui mobilise des millions de passionnés…
A l’occasion du centenaire de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), l’ouvrage « Des Hommes et des Oiseaux » rassemble plus de 300 illustrations et photographies, une chronologie détaillée pour repérer les événements clés de la protection des oiseaux et une abondante documentation internationale qui mobilise des millions de passionnés…
Au début du siècle, les ornithologues établissent des inventaires d’espèces disparues. Partout, des chasseurs, des paysans, des amoureux de la nature, de simples citoyens observent la régression des populations d’oiseaux.
Dès lors, on se mobilise pour réformer la société. Mais, cela ne suffit pas car notre monde moderne fait peser sur les oiseaux de nouvelles menaces plus complexes : pesticides, marées noires, réchauffement climatique.
Des Hommes et des Oiseaux retrace cette histoire longue et tumultueuse faite de combats au quotidien. Les protecteurs des oiseaux ont transformé le monde, en obligeant la science à réformer ses pratiques et en contribuant à la naissance de l’écologie.
Ce livre très pédagogique nous invite à nous interroger sur notre relation aux animaux sauvages, sur notre sensibilité face à la souffrance animale, ainsi que sur notre place dans la nature. Sans nul doute, une belle lecture que vous pourrez retrouver dans la bibliothèque du Relais du Vert Bois…

Dans l’enfance, ce sont souvent les premières fleurs que nous cueillons pour nos mamans ravies de ces tendres bouquets, et ces preuves de notre affection abondent opportunément le jour de la Fête des mères.
Le pissenlit se rencontre à l’état sauvage dans nos champs, les chemins et dans……les prairies champêtres du Relais du Vert Bois comme en atteste cette photo prise hier après-midi sous un soleil radieux de printemps !
Le pissenlit est facilement reconnaissable à ses longues feuilles vert foncé aux allures de dents de lion. Regroupées en petites touffes au raz du sol, les feuilles poussent au plus près de la base pendant que la tige creuse de la fleur s’allonge pour dénicher le soleil. Après la floraison d’une jolie fleur jaune vif qui a lieu de fin mars à septembre et dont raffole les insectes butineurs en raison de son caractère très mellifère, la fleur du pissenlit laisse apparaître des akènes à aigrettes qui sont ensuite dispersés par le vent ou par quelques bambins trop contents de voir de la neige en plein été.
Le pissenlit est une plante dite « hermaphrodite », qui a donc des organes mâles et femelles. Grâce à eux et à ses multiples fleurs dans son réceptacle, un insecte (abeille ou autre) peut lui permettre de s’autoféconder et ainsi de se multiplier.
Pour le reste, il s’agit surtout d’une plante comestible et nutritive aussi bien pour ses fleurs que pour ses feuilles. Ses feuilles sont riches en minéraux comme le potassium, le calcium, le cuivre et le fer, et en vitamines A (il y a davantage de bêta-carotène que dans les carottes), du complexe B, C et D. On peut les utiliser en salade, les cuire comme légume d’accompagnement. Elles peuvent également remplacer les épinards, ou compléter certaines soupes. Autrefois les fleurs entraient dans la coloration du beurre.
Ses propriétés médicinales diurétiques, dépuratives et toniques en font une plante amie du foie. Il est aussi une bonne source de fibres et des minéraux divers, particulièrement le fer et le calcium. A poids égal, le pissenlit est plus riche en calcium que le lait.

On parle de pollution lumineuse lorsque les éclairages artificiels sont si nombreux et omniprésents qu’ils nuisent à l’obscurité normale et souhaitable de la nuit. La pollution lumineuse, c’est donc l’excès d’éclairage artificiel visible en extérieur…
Ainsi, à la tombée de la nuit, d’innombrables sources de lumières artificielles (éclairage urbain, enseignes publicitaires, vitrines de magasins, bureaux allumés en permanence…) prennent le relais du soleil dans les centres urbains jusqu’au plus petit village.
La pollution lumineuse est une forme de pollution assez peu évoquée car à priori peu néfaste pour la santé lorqu’on la compare aux pollutions plus classiques, pourtant elle n’est pas sans conséquences sur le vivant et peut-être facilement réduite.
L’impact grandissant de la pollution lumineuse concerne un grand nombre d’espèces de toute taille (de l’insecte au mammifère, en passant par les oiseaux), et de tous les milieux (terrestres, aquatiques, marins). Les effets peuvent être directs (une espèce ne tolérant pas la lumière), ou indirects (perte d’une ressource pour un prédateur spécialisé, prédation accrue, disparition d’un pollinisateur entraînant la disparition de la plante pollinisée, etc.). Les perturbations peuvent concerner beaucoup d’aspects : les déplacements, l’orientation, et des fonctions hormonales dépendantes de la longueur respective du jour et de la nuit.
L’éclairage nocturne est parmi les 3 causes principales du déclin des papillons, avec l’abus de pesticides et la raréfaction des habitats. Pour certains scientifiques, ce pourrait même être la première cause de la raréfaction des papillons de nuit.
La présence permanente de lumière perturbe les cycles physiologiques comme l’alimentation, la reproduction et la ponte.
Les lampes à vapeur de mercure utilisées pour l’éclairage public sont particulièrement dangereuses : les rayons ultraviolets attirent les papillons qui tournent autour du lampadaire jusqu’à épuisement.
D’autres insectes, dit lumifuges, fuient au contraire toute source de lumière. La modification de l’environnement lumineux, notamment dans nos grandes agglomérations, a ainsi réduit considérablement les habitats possibles pour ces espèces. Pour ces insectes nocturnes, les routes éclairées deviennent de véritables barrières, cloisonnant les populations et réduisant leurs chances de rencontre et de reproduction.
Chez les vers luisants l’abondance de la lumière artificielle annule l’effet fluorescent de la femelle du ver luisant et ne lui permet plus de se faire repérer par le mâle. L’absence de fécondation entraîne la disparition de l’espèce.
Les oiseaux migrateurs paient également un lourd tribu, dont le sens de l’orientation est perturbé par l’éclairage des littoraux et des grandes agglomérations. Les oiseaux migrateurs utilisant les étoiles pour se guider, la Lune joue un rôle secondaire en éclairant le paysage. Face aux lumières artificielles de la ville, les oiseaux migrateurs se trouvent parfois désorientés. Ils discernent mal les étoiles auxquelles ils se fient pour migrer. Les zones éclairées les dévient de leurs routes, en les attirant ou en les repoussant. Les oiseaux migrateurs dépensent ainsi inutilement une énergie pourtant précieuse pour venir à bout d’un périple exténuant.
La pollution lumineuse est également un handicap pour les yeux des animaux nocturnes. Il a été par exemple mis en évidence que des grenouilles ne parvenaient plus à distinguer proies, prédateurs ou congénères. En Floride, site de reproduction principal pour la population atlantique de tortues caouannes, les jeunes naissent en général la nuit sur la plage et se ruent vers la mer, attirés par sa brillance. Mais, déviées par les lumières artificielles du littoral, elles se retrouvent sur la route et meurent de déshydratation, d’épuisement ou écrasées sous les roues d’une voiture.
Les lumières extérieures sont à l’origine d’une incroyable consommation d’énergie, souvent bien inutile. et qui représente près de 2% de la consommation électrique française. L’éclairage public représente près de 50% de la consommation totale d’électricité des communes !
En France, le nombre de points lumineux a augmenté de 30 % depuis les dix dernières années pour désormais s’élève à près de 9 millions de points, soit environ 1% de la consommation électrique en France !
L’arrivée prochaine d’éclairages publics halogènes ou LED devrait hélas accentuer le phénomène dans la mesure où les insectes sont sensibles aux plus grandes gammes d’onde qu’elles diffusent. Comme quoi, économiser l’énergie n’a pas que des avantages…


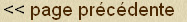
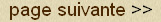













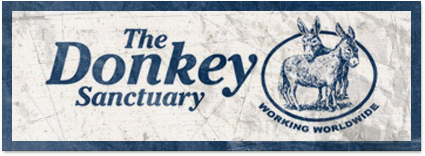
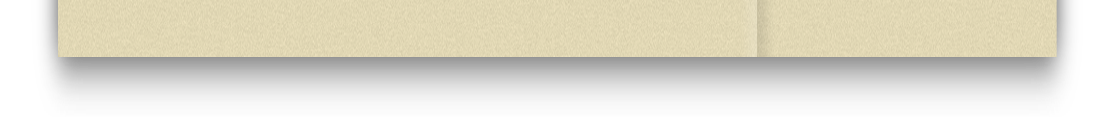
Laissez un commentaire